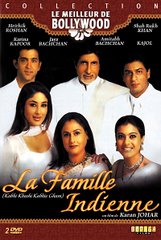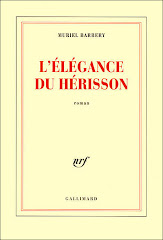Dame Noire, un village perdu au bout d’une route que personne n’emprunte plus depuis longtemps, d’une route oubliée, un endroit paisible, fait pour le repos. Mais, ceux qui se souviennent encore de ce lieu prétendent que chaque année, pendant une journée, le chaos et les forces du mal rôdent pour s’emparer des âmes égarées. Ce n’est peut-être qu’une légende, mais ce jour là dans le village, et ceci pendant 24 heures, nul ne sort de chez lui. Personne n’ose tenter le diable de peur d’être maudit pour l’éternité.
Le centre commercial de Dame Noire est une petite place autour de laquelle on trouve une boulangerie, une boucherie charcuterie, une boutique de fleurs et plantes diverses, une entreprise de pompes funèbres, un hôtel restaurant qui fait également bar, un garagiste, une droguerie et une échoppe de produits naturels. Maya, jeune herboriste (la seule et unique en France, car cette profession est censée ne plus exister), est la propriétaire de cette dernière. Elle tient ce petit commerce de sa mère, qui l’avait elle-même hérité de la sienne avant elle. Comme ses ancêtres l’ont toujours fait, elle se lève très tôt le matin, bien avant l’aurore, pour aller cueillir les plantes qui se ramassent quand la rosée les caresse : les pétales de roses qui feront des hydrolats parfumés que les femmes se passeront sur le visage comme lotions anti-rides et des huiles contre la couperose, du soucis, de la camomille, du millepertuis, toute une gamme de fleurs qui soignent le corps et l’âme, mieux que ne le feraient toutes les pharmacopées du monde. Puis, elle rentre chez elle et met sa cueillette à sécher dans un endroit sec. Avant de se rendre dans son magasin, elle attache ses longs cheveux sombres en une natte serrée qui lui donne un air plus sérieux et plus vieille (ce qui pour certains, veut également dire, plus responsable) et cache son ventre rond de future maman sous son ample blouse blanche. Elle rayonne de bonheur, offrant son sourire épanoui à ses clients ravis.
Aujourd’hui, ils se bousculent chez elle. Demain, c’est le 1er novembre, jour de mort où le Mal libéré vient frapper aux portes, hurlant, geignant, à la recherche d’âmes à dévorer, de corps à posséder, c’est le jour de la « petite mort », jour d’enfermement et de prières. Alors, ils viennent lui acheter des herbes à faire brûler, pour éloigner le mauvais œil, des huiles essentielles pour purifier leurs maisons, bref, ils viennent rechercher tout ce qui pourrait empêcher le Malin de pénétrer dans leurs demeures.
Ce matin là, Maya est encore plus heureuse que d’habitude, si c’est possible. Depuis quelques semaines, elle se trouvait fatiguée par cette fin de grossesse. Grâce à cette légende du village, elle va pouvoir se reposer pendant 24 heures, derrière ses volets clos, goûter au plaisir d’une journée à ne rien faire, dans les bras de son tendre époux. Elle sourit déjà en y pensant. Pour elle, ce jour redouté de tous sera un instant volé au paradis, dans leur nid douillet.
Mais en attendant, elle doit terminer cette journée. Elle a tout juste le temps de faire une petite pause à midi, pour grignoter un sandwich et s’asseoir une demi-heure sur une chaise, dans l’arrière-boutique. Déjà, l’après midi arrive, avec son flot de clients. Sur la porte de la boutique, la jeune femme a accroché une pancarte où il est écrit :
« Exceptionnellement, nous serons fermés, ce jour, à 16 heures – Merci de votre compréhension ».
Les derniers clients se précipitent vers 15 heures 30. A l’heure dite, dès qu’elle a fini de servir les uns et les autres, Maya referme la porte avec de grosses clés en cuivre et baisse le rideau de fer. Elle passe dans l’arrière boutique et retire sa blouse, qu’elle accroche au portant de fer forgé, libère sa chevelure qui en profite pour s’étaler sur ses épaules et s’écouler le long de son dos. La jeune femme aime bien ce lieu qui sent les huiles et les herbes séchées. Ici, elle a classé, comme d’autres l’ont fait avant elle, les plantes sur les étagères du mur sud, dans l’ordre alphabétique, et les huiles coté ouest. Tout est en ordre, d’une grande propreté. Satisfaite de son inspection, Maya se dirige vers le coin lavabo. Elle se lave les mains et jette un coup d’œil rapide sur son reflet que lui renvoie un miroir ovale accroché au mur blanc, peint à la chaux. Elle passe une brosse souple sur la masse noir et brillante qui encadre son visage et se sourit. Elle est belle. Ses grands yeux bleus contrastent avec sa peau dorée. Ses lèvres rouges et pulpeuses semblent gorgées de sang.
Enfin, elle se détourne et prend l’escalier qui monte vers son appartement, juste au dessus. Il va lui falloir encore aller dans les bois chercher des écorces, des racines, de petites plantes aux vertus miraculeuses, qu’elle triera demain, mais pour le moment, elle veut s’offrir une petite pose. Il n’est que 16 heures, elle a largement le temps. Arrivée chez elle, elle se dirige vers la cuisine pour se préparer un thé.
C’est à ce moment là qu’elle croit entendre les lattes de bois du parquet craquer. Elle tend l’oreille. Le bruit s’est arrêté. Elle pense avoir rêvé et attrape une tasse pour la remplir d’eau. Mais les bruits reprennent. Elle appelle, interrogative :
« Franck, c’est toi ? ! »
Personne ne répond. Mais les craquements continuent.
Elle repose sa tasse sur une table et cherche du regard quelque chose pour se protéger. Elle ne trouve rien d’autre qu’une fourchette et la prend, la tenant bien serrée dans sa main droite, comme une arme de défense. Elle ne sait pas si c’est l’arrivée du 1er novembre ou son état de femme enceinte qui la rend si sensible, irritable, vite angoissée, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle a peur. Elle voudrait se cacher, se faire toute petite, disparaître, mais dans son enfance, on lui a toujours répété qu’il faut savoir se battre et ne pas tourner le dos au danger, le regarder droit dans les yeux. Elle se sermonne intérieurement et part affronter l’inconnu. Elle s’avance, se dirigeant en fonction des craquements. Elle sort de la cuisine, emprunte le couloir qui la mène vers le salon. D’un coup d’œil rapide, elle inspecte la pièce. Son regard passe sur la bibliothèque remplie d’ouvrages divers, sur le canapé, la commode sur laquelle trône, comme dans chaque maison du village, un étrange sablier noir. Tout est à sa place. Il n’y a rien d’étrange ici ; personne ne semble s’y cacher. Elle regarde tout de même derrière les rideaux, qu’elle soulève d’un seul coup, prête à frapper l’intrus. Là encore, il n’y a que la fenêtre en face d’elle, et derrière la fenêtre, la rue principale de Sable Noir, avec son vieux réverbère d’un autre temps. Elle laisse retomber les rideaux et continue à chercher la source des craquements qui s’arrêtent et reprennent de façon irrégulière. Elle s’énerve de plus en plus, ses gestes deviennent plus rapides, moins précis. Sa respiration s’accélère. Elle sent que la panique tente de s’emparer d’elle. Pourtant elle résiste. Maintenant, les craquements semblent venir de sa chambre. Elle s’y rend, attend un instant derrière la porte, puis la pousse lentement, grimaçant en l’entendant grincer sinistrement. Mais là aussi, elle ne voit rien d’autre que son grand lit aux draps bien tirés, comme une invite au repos. Elle entre dans cette pièce qu’elle adore plus que toute autre. Les bruits se sont arrêtés. Elle tend l’oreille. Mais il n’y a vraiment plus rien. Alors elle se détend, elle laisse retomber sa main et pose la fourchette sur la table de nuit. Elle s’assied sur les draps blancs et murmure, en se caressant le ventre :
« Et bien, je crois qu’il serait temps que tu sortes, mon poussin. Ta maman en arrive à être si fatiguée qu’elle panique pour un … »
Elle n’a pas le temps de terminer sa phrase, qu’un poids gigantesque la plaque sur le lit. Elle voudrait hurler, mais sa gorge est bloquée. Elle ne peut plus rien faire, prisonnière de cette force qu’elle ne peut visualiser. La panique a gagné le combat qu’elle menait contre elle. Maya ne voit plus rien, n’entend plus rien. Seul compte son envie de vivre, son refus de mourir là, bêtement, attaquée par elle ne sait quel fou. Elle tente de se débattre, libère un bras et frappe, frappe, avec force, avec rage, avec tout le désespoir qui est en elle.
Soudain, une voix parvient à traverser son oreille pour arriver jusqu’à sa conscience :
« Aie ! Tu m’as fait mal ! »
Le poing de Maya, qui se préparait à frapper encore, s’arrête, comme frappé par la foudre en plein élan. Elle ouvre les yeux qu’elle avait gardés fermés et rencontre le regard boudeur de Franck.
La panique disparaît, en une fraction de seconde et laisse la place à la colère. Elle s’indigne :
« - Imbécile ! Tu m’as fait peur ! Pourquoi tu n’as pas répondu quand je t’ai appelé ? T’es cinglé où quoi. Tu as failli me faire mourir de frayeur. C’a va pas la tête ? Qu’est ce qui t’a pris ?
Il baisse les yeux, penaud, mais ne peut empêcher ses lèvres de sourire quand il répond :
- Désolé ma puce. Je ne voulais pas faire ça, promis. Mais quand j’ai entendu ta petite voix demander « c’est toi Franck ? », je n’ai pas pu résister. Je suis un imbécile. Tu as raison. Pardonnes-moi ! Je t’aime. »
Il l’embrasse tendrement. Elle se love contre lui. Ils s’enlacent. Toute la douleur, toute la colère disparaissent. Ils oublient tout ce qui n’est pas eux et leur amour. Ils se pardonnent sans avoir à parler, juste avec les gestes éternels de deux amants qui se redécouvrent. Il la déshabille, caresse son ventre proéminent, ses seins rebondis. Il lui susurre qu’il l’aime et qu’il l’aimera toujours, qu’elle est sa vie, son âme, sa force. Il frotte son visage dans sa chevelure de nuit en lui avouant qu’il ne pourrait plus vivre sans elle, qu’elle est sa nourriture divine.
Elle se gorge de chacun de ses mots qui la pénètrent. Elle se donne, avec un plaisir renouvelé à cet homme dont elle ne pourrait plus se passer. Elle lui offre son corps pour qu’il se repaisse. Ses lèvres s’entrouvrent, laissant échapper une mélopée incontrôlée. Elle laisse le plaisir la submerger.
Il est elle ; elle est lui. Nul ne pourrait les séparer car leur amour est plus fort que tout.
Quand leur danse s’achève, Maya s’aperçoit qu’il est déjà 19 heures. Elle sourit à son amant, l’embrasse une dernière fois et se dirige vers la salle de bain où elle va prendre sa douche. Elle est bien. Elle sent son corps fatigué mais détendu, comme à chaque fois qu’ils font l’amour. L’eau lui redonne de nouvelles forces. Elle se frictionne avec du savon d’Alep qu’elle fait venir de Syrie, se rince et sort pour se sécher et s’habiller. Elle met un pull-over et un pantalon large. Elle retourne dans la chambre. Franck est toujours allongé sur le lit défait. Il a les yeux fermés.
« Tu dors ? » demande-t-elle.
« Humm ! » Répond-t-il avec force.
«- Je vais faire ma cueillette, reprend-elle. Je n’en ai pas pour bien longtemps. Je devrais être rentrée d’ici une heure. Ok ?
- …
- Et oh, gros fainéant, tu m’entends ?
- Oui, oui, d’ici une heure. Ne traîne pas. Je fais une petite sieste d’un quart d’heure, puis je nous prépare un bon dîner en amoureux pour quand tu reviens.
- O.K. A tout à l’heure. Je t’aime.
- T’aimes… »
Maya quitte la chambre. Elle prend son vieux sac à dos en tissu rapiécé dans un placard du salon et part en claquant la porte. Elle n’emmène pas de clés, à quoi bon ? Franck est là, à la maison et lui ouvrira quand elle rentrera. Arrivée dehors elle tourne la tête vers la lune qui semble lui sourire. Dans les rues, il n’y a déjà presque plus personne. Les volets des maisons sont pratiquement tous fermés.
Bientôt, elle sait qu’il n’y aura plus une fenêtre de visible. Les rideaux seront tirés sur les jalousies rabattues. Toute la population de Dame Noire se sera calfeutrée. A partir de minuit, et jusqu’à la même heure, un jour plus tard, il pourrait y avoir une guerre, un être humain à l’agonie en train d’appeler, de crier, de supplier dehors, personne ne bougerait, personne n’oserait même tenter de regarder ce qui se passerait à l’extérieur.
Pour le moment, le bar est encore éclairé. Il fermera vers 22 heures, au lieu de minuit les autres jours de l’année et ne rouvrira que le 2 novembre au matin, quand le village se réveillera de sa longue sieste.
Maya marche d’un pas lent, tranquillement. Elle a le temps. Elle désire profiter de ces dernières heures de liberté. Elle veut se gorger de cet air frais de fin de journée, elle s’abreuve d’humidité. Elle écoute la nature qui chante sous ses pas : l’herbe qui se courbe sous son poids et se redresse derrière elle, les branches mortes qui se brisent, les feuilles roussies qui s’effritent. Elle arrive sous le couvert des arbres. Elle ne songe pas à pénétrer très profondément dans le monde des bois. Elle veut juste marcher un petit peu. Elle laisse aller son regard sur le sol jonché de toutes ces plantes qui soignent et aident à vivre, ces plantes que d’autres foulent sans même y songer. Elle ramasse des tiges qu’elle seule sait reconnaître. Avec un petit couteau, elle détache des morceaux d’écorces d’arbres divers, du chêne pour faire une décoction pour les engelures ou les diarrhées, du hêtre pour les accès de fièvre, de l’aulne pour les blessures, les plaies, les ulcérations.
Maya se sent bien. Cette forêt, c’est son univers, son autre maison, son petit coin secret, un lieu où elle peut venir se ressourcer, se retrouver, réfléchir quand elle en a besoin. C’est là qu’elle est née, il y a vingt ans à peine. Ce sont ces arbres centenaires que ses yeux ont découverts en s’ouvrant sur la vie. C’est cette terre qui a bu les eaux qui s’écoulaient du ventre maternel. Entre les racines d’un de ces troncs, a été enterré le placenta qui l’avait protégé pendant neuf mois. C’est ici qu’un jour, elle aimerait pouvoir mourir et être enterrée, au soir d’une longue vie bien remplie.
Elle marche au hasard, heureuse de profiter de ce répit avant l’enfermement annuel. Elle connaît chaque arbre qu’elle caresse sur son passage, qu’elle hume avec bonheur. Elle se baisse, prend une poignée de terre entre ses mains et la porte à son visage. Elle respire pleinement cette odeur si particulière qui lui rappelle les mains caressantes de sa mère trop tôt décédée. Elle se souvient que même quand celle-ci se les lavait avec du savon noir et une brosse, elle n’arrivait jamais à se débarrasser totalement de l’odeur de la forêt. Elle se relève et continue à marcher en rêvassant.
Soudain, elle entend les cloches de l’église sonner. Elle compte les coups : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.
« Mon Dieu » songe-t-elle. «Cela fait déjà si longtemps que je suis partie. Franck doit s’inquiéter. Il va vouloir partir à ma recherche. Il faut que je rentre le plus rapidement possible ».
Elle se retourne, pensant voir les lumières du village au loin, entre les arbres. Mais elle a beau scruter l’horizon, nul éclairage ne papillote au lointain. Elle réalise alors qu’elle s’est enfoncée dans les bois beaucoup plus profondément qu’elle ne le voulait. Il lui faut donc se dépêcher. Elle repart dans l’autre sens, vers la civilisation, l’abri. Elle sait qu’il lui faut faire plus vite. Elle tente d’accélérer l’allure. Son ventre ne lui permet pas de courir, mais elle réussit tout de même à faire des pas plus grands. Sa maison n’est plus loin, à un kilomètre, à peine. Si elle garde un bon rythme, elle sera chez elle d’ici une demi heure.
Elle est perdue dans ses pensées, le regard tourné vers son foyer, oublieuse du chemin qu’elle foule. C’est pour cela qu’elle ne voit pas la racine qui ressort, sur le terrain feuillu, tel un serpent à l’affût. Son pied droit se prend dedans et la retient en arrière alors qu’elle est lancée vers l’avant. Elle trébuche, tente de se retenir à une branche, un tronc d’arbre, n’importe quoi. Mais ses mains battent dans le vide follement, désespérément et son poids la projette inexorablement vers le sol. Une douleur terrible lui mord la cheville au moment où elle s’écroule sur un tas de feuilles grasses. Son cri de souffrance ne franchit ses lèvres que pour s’éteindre dans la terre qui entre dans sa bouche. Elle se redresse, s’assied, crache et se frotte le visage. Elle se tâte le ventre, affolée à l’idée que son bébé ait pu être blessé par la chute. Elle le sent bouger contre sa paume. Cela la rassure. Elle sourit malgré la douleur. Il est là, bien au chaud, à l’abri dans son nid protecteur. Puis elle grimace : elle sent naître une ecchymose sur son front. Du sang coule dans ses yeux. De son sac, elle sort des feuilles de plantain qu’elle froisse et pose sur la blessure pour l’empêcher de s’infecter. Puis elle inspecte sa cheville. Elle est douloureuse, certainement luxée, mais il lui faut savoir si elle est capable de marcher malgré la douleur qui l’irradie.
Maya tente de se relever, mais la douleur ne disparaît pas, au contraire. Elle retombe sur le sol, incapable d’en supporter davantage. Son mollet est enflé. Il est déjà noir et la souffrance est de plus en plus forte, aiguë, remontant lentement le long de sa cheville jusqu’au haut de la jambe. Maya pleure de désespoir et de peur. Comment rentrer chez elle maintenant ? Elle hurle, appelle à l’aide :
« Au secours ! Il y a quelqu’un ? A l’aide ! Je vous en supplie ! Venez m’aider ! Franck ! Je t’en prie ! Je suis blessée ! Au secours ! A l’aide !»
Mais personne ne répond à ses suppliques. Le village s’est refermé sur lui-même. Personne ne l’entend. Et même si cela était, qui pourrait bien risquer une sortie dans la forêt, à moins de deux heures du jour maudit ? Qui pourrait vouloir risquer sa vie pour sauver celle de Maya ?
La jeune femme pense à son époux. Lui va venir. Leur amour est plus fort que tout, plus fort que les malédictions. Ensemble, ils peuvent tout vaincre. Et puis, elle songe à une conversation qu’elle avait eue avec sa mère, il y a quelques années, avant que celle-ci ne s’éteigne :
«- Joue avec, ma fille ; amuse toi avec lui tant que tu veux, mais ne l’épouse pas. Il est beau, il est gentil, j’en conviens. Mais, alors qu’il n’est pas d’ici, qu’il ne vient que pour les vacances, il semble plus empreint de nos croyances que certains de ceux qui vivent là depuis des générations. Et ce n’est pas le genre d’homme à se battre contre ça !
Mais elle lui avait répondu :
- Mais maman, il est tel qu’il est ; je ne lui demande pas d’être différent. Il m’aime et je l’aime, c’est tout ! Rien n’a plus d’importance que ça, à mes yeux. »
Et la conversation s’était arrêtée là. Plus jamais on en avait reparlé. Pourquoi, ce soir, cette scène lui revenait-elle en mémoire ? Elle ne devait pas y songer. Elle croyait en la force de l’amour ; cela seul comptait.
Dans leur maison, Franck s’était réveillé. Comme promis, il avait préparé un bon dîner pour bien commencer ces 24 heures en tête à tête. Il avait décoré la table avec goût, installé un bougeoir entre leurs assiettes, sur une belle nappe brodée à l’ancienne. Il avait mis une bouteille de vin blanc au frais. Avec l’aide d’un livre de cuisine, il avait préparé une salade de fruits de mer qui attendait au réfrigérateur pendant qu’une tarte aux pommes finissait de cuire dans le four. Puis, il avait commencé à attendre son épouse en regardant la télévision. Mais, à 21 heures, ne la voyant pas rentrer, il avait commencé à s’inquiéter. Sa petite Maya n’avait pas l’habitude d’être en retard. Elle était même plutôt le type de femme d’une ponctualité quasi draconienne. Tout ça ne lui semblait pas normal ! Il avait dû se passer quelque chose. Il décida donc de sortir à sa recherche. Il avait enfilé une veste, avait ramassé ses clés puis il était parti, criant le nom de Maya dans les rues et ruelles, s’informant auprès des derniers passants qui auraient pu la croiser. Certains ne l’avaient pas revue depuis qu’elle avait fermé sa boutique, d’autres se souvenaient l’avoir aperçue se dirigeant vers la forêt avec son fameux sac à dos. Elle avait même discuté un instant avec le vieux Mathieu à qui elle avait promis de ramener une plante miracle qu’elle ferait macérer dans de l’huile d’olive pour soulager son arthrite. Franck avait donc marché jusqu’à l’orée de la forêt et l’avait appelée, d’abord doucement, comme pour ne pas déranger les voisins à cette heure tardive, puis plus fort, jusqu’à crier de tout son être. Mais nul ne lui avait répondu. Il avait fait quelques pas sous le couvert des arbres. Il avait fait demi-tour, puis y était retourné. Mais, il n’avait pas osé aller plus loin. Il se trouvait mille excuses pour ne pas pousser ses recherches plus avant. Il se disait que Maya ne pouvait être partie dans les profondeurs des bois, non ! Pas alors qu’on était la veille du 3 novembre, pas alors qu’elle était enceinte et à quelques jours d’accoucher. Non ! Elle était peut être déjà rentrée par un autre chemin. Il devait retourner chez eux, à la maison. Il devait aller l’attendre là-bas. Elle allait bientôt rentrer, il en était certain. Peut-être s’était-elle attardée chez un voisin, sur le chemin du retour. Peut-être était-elle déjà chez eux, à regarder par la fenêtre si elle le voyait apparaître, à s’inquiéter pour lui, comme il s’inquiétait pour elle.
Alors, il avait refait le chemin à l’envers, il avait ouvert la porte de sa maison avec les clefs qu’il avait emportées. Il avait appelé sa femme, sa vie, son âme. Mais personne ne lui avait répondu. Il s’était laissé tomber sur un fauteuil vert émeraude. Il était resté là, à l’attendre, l’oreille aux aguets, prêt à répondre à son appel, s’il l’entendait, prêt à lui ouvrir, si elle revenait, prêt à courir à sa rencontre.
Maya pleure. Elle se laisse aller à tout le désespoir dont elle est capable. Cinq minutes, pas plus, c’est tout ce qu’elle s’accorde. Puis elle s’essuie les yeux et examine la situation : ne pouvant se relever, elle ne peut plus marcher et il est inutile de se fatiguer à crier puisque personne ne viendra. Elle n’a que deux solutions : attendre de mourir ici, seule, dans la forêt, ou se déplacer par n’importe quel moyen. Le choix est vite fait et elle décide de ramper jusqu’à la maison. Elle sait qu’il lui reste moins de deux heures. Mais, si tout va bien, elle sait aussi qu’elle en est capable. Alors, elle s’élance. Les deux bras en avant, elle s’accroche à la terre, aux racines, à tout ce quelle trouve sous ses mains et avance, centimètres par centimètres.
Elle n’a plus rien de la belle jeune femme qui sortait de sa boutique quelques heures auparavant, elle n’a plus rien de l’amante comblée. Ses cheveux sont emmêlés. Des feuilles et de petites branches s’y sont accrochées. Ses joues noircies, griffées par des ronces laissent couler des larmes de sang. Ses yeux gonflés, rougis, emplis de peur, n’ont plus rien du regard bleu serein qui se contemplait dans le miroir. Ses lèvres ne sourient plus. Elles ont pris un pli amer, et le sang séché qui s’y est collé les fripe comme de vieilles pommes. Ses vêtements se déchirent contre une pierre qui en profite pour lui ouvrir la peau, contre une branche pointue, fichée dans le sol et qui se plante dans sa jambe. Mais elle ne ralentit pas pour autant, gagnant un mètre, puis deux. Bientôt, alors que l’horloge vient tout juste de sonner 23 heures, elle sort enfin de cette forêt tant aimée, qui vient de la trahir.
Là, elle s’arrête un instant. Elle sait qu’elle va croiser le regard affolé de Franck. Il ne peut en être autrement. Il est venu, il l’a attendu. Ils ne peuvent vivre l’un sans l’autre. C’est leur amour qui va la sauver.
Mais, à l’orée des bois, il n’y a personne.
Le désespoir l’emplit une nouvelle fois. Les larmes si difficilement refoulées viennent, à nouveau, tracer sur son visage tuméfié des sillons de tristesse. Elle se sent seule et sans force. Elle n’aura pas le courage de ramper à nouveau jusqu’à la maison. Elle est trop fatiguée maintenant. Elle n’a qu’une envie, c’est de rester là, de poser sa tête sur les feuilles tièdes et de dormir, d’oublier sa douleur, sa tristesse, sa frayeur ; oui, dormir, elle ne veut plus que dormir. Et son visage doucement s’affaisse et ses yeux se ferment…
C’est à ce moment là qu’un bébé, qui était resté neuf mois à l’abri, décide de se faire entendre. Dans une contraction douloureuse qui la fait se redresser, Maya sent les eaux couler entre ses jambes. Son enfant est en marche pour la vie. La femme pleure et rit en même temps. Elle veut bien mourir, mais ne désire pas emporter son petit avec elle dans l’au delà. Pour le moment, il a besoin d’elle et il le lui rappelle. Pour lui, elle doit survivre, elle doit continuer à ramper, malgré la souffrance, malgré le désespoir.
Et elle repart. Maintenant, ce n’est plus la terre de la forêt qu’elle a sous le corps, mais le bitume de la route qui écorche ses mains, à chaque seconde un peu plus, ses mains qui ne sont plus qu’un tas de chairs à vif, qui laissent des traces rouges sur l’asphalte. Son pantalon est en lambeaux. Ses genoux à vif dans lesquels s’enfoncent de petits cailloux la font atrocement souffrir. Mais toutes les limites sont faites pour être refoulées, même celles de la tolérance. Alors, Maya continue d’avancer. Elle doit cependant s’arrêter à chaque nouvelle contraction, tentant de respirer comme le lui a appris l’accoucheuse du village.
Soudain, elle pousse un hurlement. Quelque chose vient de la toucher, de lui frôler la jambe. La mort est-elle déjà là ? Le 1er novembre s’est-il déjà installé sans qu’elle ne s’en rende compte ? Non ! Ce n’est pas possible. Ce serait trop injuste. Paralysée par la peur, elle reste là, sans bouger, le visage collé au goudron. Mais, la « chose » revient et lui mort la cheville avec plus de violence encore. C’est la souffrance qui la fait crier maintenant. Elle ne peut pas rester là, à se laisser dévorer sans se battre. Elle se retourne et aperçoit une sorte de chauve-souris noire, longue de 50 centimètres environ, qui l’observe de ses grands yeux verts globuleux emplis de gourmandise. La femme et l’animal s’observent, se jaugent. La forme sombre sortie de l’ombre ouvre sa grande gueule rouge du sang de sa victime et montre ses crocs pointus en grognant. Maya ne comprend pas bien comment une bestiole si insignifiante peut avoir eu le courage de l’attaquer. Elle sait qu’elle est à terre et blessée, mais tout de même. Rares sont les animaux qui osent s’en prendre à des humains. Puis, en y regardant mieux, elle découvre que l’ombre est suivie d’autres ombres, toutes aussi imposantes qu’elle. Toutes semblent sourire, les babines retroussées, les crocs rougis, impatientes de reprendre leur festin. Oui, Il n’y a pas un ennemi mais tout un groupe, une armée d’assaillants, qui pensent avoir trouvé une proie facile, un animal blessé pour se régaler sans se fatiguer. Maya laisse sa terreur se transformer en rage et explose. Elle grogne, elle crache, elle rugit, elle tempête et gesticule tant et si bien que les pauvres bêtes affolées préfèrent aller chercher pitance ailleurs. Un coup d’oeil sur sa cheville suffit à la jeune femme pour voir qu’un morceau de chair a disparu, laissant une plaie sanguignolante. Elle regarde son tibia avec effroi et surprise. Elle sait, maintenant, ce que veut dire « se faire dévorer vivant ». Puis elle se reprend. Il est temps de reprendre la route vers la vie.
Les mètres succèdent aux centimètres, les minutes aux secondes. Maya rampe toujours. Elle sent, dans son ventre, l’enfant qui rampe également, millimètres après millimètres, dans la douleur et dans le sang, mais avec la même rage de vivre que sa mère.
Enfin, elle voit la fenêtre de sa maison. Elle est éclairée. Elle s’approche encore, un tout petit peu encore. Ca y est, elle est sauvée. Elle n’a plus qu’à appeler et Franck pourra venir la chercher. Il va l’emporter dans ses bras, il va la soigner, la baigner, lui faire oublier toute cette horreur. Elle n’a plus qu’à crier son nom.
C’est à ce moment là que les douze coups de minuit sonnent !
Elle pousse un cri de rage puis se ressaisit. Héler Franck. C’est tout ce qu’elle a à faire, l’appeler. Et tout s’arrêtera. Ce cauchemar se terminera. Son enfant naîtra dans leur lit, là haut, sous le regard gêné mais heureux de son père. Oui ! Tout cela va devenir réalité, si elle a la force de crier. Elle reprend son souffle et hurle le nom de son sauveur en un cri qui pénètre, une à une, toutes les demeures de Dame Noire :
« FRANCK ! Au secours ! »
Dans la maison, il a entendu les douze coups de minuit sonner et les larmes se sont mises à couler sur son visage. Son amour, sa femme adorée, sa vie, son âme est morte. Il n’est plus que souffrance. Comment vivre encore après cela ? Comment accepter de respirer une minute supplémentaire quand l’amour n’est plus ? Et puis, soudain, il reconnaît une voix qui l’appelle :
« Franck ! Au secours ! »
Il n’y a pas de doute possible, c’est sa voix à elle. Elle vient de dehors, elle vient de la rue. Il court jusqu’à la fenêtre et la voit. Elle est allongée sur le sol, éclairée par le réverbère au pied duquel elle s’est affalée. Elle est blessée. Il va la sauver. Il court jusqu’à la porte d’entrée. Il tourne la poignée… et la relâche avec horreur. Non ! Il ne peut pas ! C’est le 1er novembre. Il ne doit pas sortir sous peine de voir le mal s’emparer de lui, le dévorer, le tuer ou pire encore. Lentement, désespérément, Il prend ses clés et les tourne dans la serrure, se calfeutrant dans son abri. Il ne sait plus quoi faire, il ne se comprend plus lui même. Sa lâcheté le surprend, le foudroie. Il avait toujours pensé être un homme bon, prêt à défendre les êtres dans le besoin. Mais aujourd’hui, face aux ombres du démon, il a peur, il tremble. Il comprend qu’il aime sa femme, qu’il l’adore, mais moins que sa propre vie. Il se rend compte qu’il est capable de sacrifier Maya pour ne pas risquer de rencontrer le Mal.
Il la trahit dans la honte, dans les larmes. Il se déteste et, pour se punir, se force à aller à la fenêtre du salon, celle qui donne dans la rue. Il se doit, il lui doit d’être là jusqu’au bout. Ce sera sa punition, son tourment éternel.
Maya appelle et appelle encore. Que fait-il ? Pourquoi n’est-il pas à ses cotés ? Elle regarde la porte avec espoir. Tout son corps tremble, de peur, de fièvre aussi. Tout son corps est tendu vers cet espace qui va s’ouvrir pour elle, d’un instant à l’autre. Tout son corps attend ; il n’est qu’attente, une longue, une éternelle attente de quelques secondes. Mais là bas, rien ne bouge. Alors, un soupçon de compréhension se fait dans son esprit. Elle n’a plus mal. Elle n’a plus peur. Quand elle lève la tête vers la fenêtre, elle n’est plus que chagrin.
Il est là, les mains plaquées de chaque coté de son visage, scotchées à la vitre. Il pleure, il la regarde. Telle une statue de marbre, il ne bouge pas. Et elle sait déjà qu’il ne bougera plus tant qu’elle gardera un souffle de vie. Il ne la sauvera pas. Lui, son homme, son héros, s’est transformé en un être pétri de faiblesses et de peurs. Il ne combattra pas le mal pour elle. Il ne prendra pas ce risque. Tout ce qu’il peut lui offrir, c’est ce regard qui va l’accompagner jusqu’au dernier instant, ce regard qui l’a fait chavirer tant de fois et qui, cette nuit, la déchire et la tue plus sûrement que les légendes.
Maintenant, elle sait qu’elle va mourir. Mais cela ne lui importe plus. Elle a perdu ce qui faisait que sa vie valait le coup d’être vécue. Elle a perdu son amour, son âme. Elle s’allonge sur le sol froid et attend la mort, l’accepte, l’espère. Elle ferme les yeux, refaisant vivre pour elle seule ces moments magiques qu’ils ont vécus à deux. Dans son corps, elle sent l’enfant progresser lentement. Il ne sait pas encore qu’il est condamné. Il continue de ramper. Elle lui envoie tout son amour, tout ce qui lui reste d’amour, celui de la maman qu’elle ne sera jamais.
Les heures passent ainsi, dans l’attente, rythmée par les contractions et les cloches qui égrènent les heures. Il est huit heures du matin quand elle sent la mort s’approcher d’elle. Alors, elle rouvre les yeux, elle les tourne vers la fenêtre éclairée où Franck veille. Il n’a pas bougé. Les larmes ont séchées sur son visage mais il continue de la regarder, semblant vouloir graver chaque instant dans sa mémoire. Elle lui sourit, d’un faible petit sourire, fragile, difficile à faire naître avec ce sang séché qui lui paralyse les lèvres. Dans son regard, elle tente de faire passer toute la compassion dont elle est capable. L’amour est mort. Il reste la compréhension, l’acceptation et le pardon qu’elle lui offre comme un ultime cadeau. Elle sait qu’il n’oubliera jamais cet instant là.
Il reçoit ce regard et ce sourire comme un coup de poignard supplémentaire. Ce pardon, il n’en voulait pas. Il aurait préféré sa haine, ses insultes. Mais comment pourra-t-il vivre maintenant avec ce regard si doux. Elle était sa merveille. Il pensait être son dieu. Mais il ne faisait que vivre dans la magie qu’elle créait pour eux. Il sait, maintenant, qu’il est faillible, humain, ni bon, ni mauvais, seulement un être de chair et de sang avec ses propres démons si forts, trop forts.
La mort s’est approchée doucement. Elle s’est installée aux cotés de la mourante. Elle lui caresse le visage et attend que la femme capitule et se rende.
Maya a oublié Franck. Elle sait qu’elle va mourir, mais elle veut faire un ultime cadeau à la vie. Alors, elle se bat encore un peu, juste quelques heures encore. Et la mort accepte et attend.
Les cloches de l’église ont sonné les heures du matin et les heures de l’après midi. Maya vit toujours. La nuit revient étendre son manteau sur le village de Dame Noire qui l’a vu naître et qui la voit mourir. Dans un ultime effort, elle aide l’enfant à sortir de son ventre en poussant, aussi fort qu’elle le peut. Elle laisse échapper un faible râle et recommence. Elle voudrait que tout s’arrête, que tout soit fini ; se reposer, se laisser aller et dormir. Mais il lui faut faire un dernier effort, juste un, encore un tout petit… Encore un et ce sera le dernier.
Enfin, minuit est là ! On est le 2 novembre. Maya sent un corps chaud qui gesticule entre ses jambes. Elle ne le verra pas, mais elle sait qu’il est là et qu’il est vivant. C’est son bébé, son enfant, l’ultime trésor qu’elle laisse au monde. Elle est maman. Ce n’est peut être pas ainsi qu’elle avait désiré ou rêvé que cela se passe, mais cette nuit, cela lui suffit. Une larme coule sur sa joue jusque sur ses lèvres qui esquissent un faible sourire. Alors, elle tend une main blanche vers la mort qui l’a assistée jusqu’au dernier moment et rend son dernier soupir.
Comme en échos, les cris de son enfant nouveau né déchirent la nuit.
Franck, les mains rivées sur les vitres de la fenêtre du salon voit sa femme mourir. Il est là depuis des heures, il ne sait pas depuis combien exactement. Mais à peine entend-il minuit sonner, qu’un cri déchire son âme, et le réveille. Il a laissé mourir sa vie ; il ne peut abandonner son enfant qui l’appelle.
Il court jusqu’à la porte, fait tourner la clé dans la serrure. Il ouvre, court dans l’escalier et se précipite dans la rue. Non, il n’est pas un héros. Il sait qu’il ne risque plus rien puisqu’on est le 2 novembre. Il s’approche du corps inanimé de celle qu’il a cru tellement aimer. Entre ses jambes, dans la chaleur d’un pantalon bouffant, un nourrisson gémit. Alors Franck hurle pour alerter les voisins. Des fenêtres s’ouvrent. La sage-femme accourt. Elle sépare l’enfant de sa mère que peut emporter le croque mort.
Franck serre son fils entre ses bras. Il va lui donner tout l’amour qu’il a volé à sa mère. Pour lui, il le sait, il deviendra un véritable héros.
Dans sa maison, il lave et habille le petit corps fatigué et va le poser dans le lit qu’ils avaient choisi à deux. Il laisse le petit bout s’endormir et s’éloigne. Il referme la porte de la chambre. Il s’en va pleurer sur le destin.
Dans la petite chambre d’enfant, le bambin ouvre les yeux et sourit de façon machiavélique. Il savait bien qu’un jour où l’autre, il trouverait une façon de rentrer dans une de ces maisons calfeutrées. Un corps lui a été offert, qu’il s’est empressé de faire sien. Le jeu ne fait que commencer !
Et ses yeux rouges se referment sur un paisible sommeil.